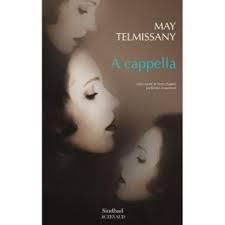/image%2F1010532%2F20140427%2Fob_01c2c8_may.jpeg)
Ce qui est frappant lorsque vous rencontrez May Telmissany, écrivaine égyptienne de quarante neuf ans, traduite de l’arabe aux éditions Actes Sud, c’est son français parfait qui provient de la « grande histoire » qu’elle évoque volontiers entre son pays et la France ; c’est aussi sa jovialité communicative et surtout son ouverture d’esprit que l’on ressent par ailleurs fortement dans ses écrits.
Son dernier roman, A capella, qui vient de paraitre[1], et qui de surcroit n’est pas explicitement situé géographiquement, signe d’une aspiration à l’Universel, ne fait pas exception à cette règle.
Cette ancienne élève du lycée français du Caire[2] , devenue une intellectuelle engagée, sensible aux bouleversements de la société égyptienne, refuse pourtant ouvertement « les chemins battus » de la littérature d’engagement et a choisi, depuis ses débuts, d’explorer les voies de l’intime féminin dans un monde menacé par la domination masculine, prônée notamment par un islamisme triomphant sur un de ses terrains de prédilections : l’Egypte moderne.
Ce positionnement de l’écrivaine est évidemment propre à déclencher la critique, ce qui ne manqua pas d’être le cas depuis la parution de son premier roman « Doniazade » publié en français en 2000.
C’est à cette période que nous nous sommes rencontrés longuement une première fois pour un entretien radiophonique chez son éditeur rue Séguier à Paris.
May Telmissany a commencé par publier au Caire un recueil de nouvelles[3] avant la sortie de ce premier roman[4]. Elle est également traductrice et professeur de littérature et de cinéma à l’université d’Ottawa où elle réside depuis 1997. Nos riches échanges autour de cette première œuvre intimiste et personnelle, et surtout nouvelle pour l’observateur et le lecteur modeste et épisodique que j’étais de Naguib Mahfouz, de Gamal Ghitany, de Sonaallah Ibrahim ou même de l’autre grand écrivain égyptien francophone, Taha Hussein sans oublier Tawfiq al-Hakim, qui suivit également ses études à Paris et au théâtre duquel notamment je tenais et je tiens toujours beaucoup.
J’avais alors vite ressenti qu’elle était la digne héritière de ces écrivains égyptiens majeurs mais qu’elle souhaitait également marquer, avec son regard de jeune femme, une rupture avec leur écriture. Ou dit autrement, c’est sans doute parce qu’elle marquait cette rupture qu’elle est devenue leur digne héritière.
En dehors de ce premier roman, nous avions évoqué ensemble l’Egypte et la nécessité de l’engagement politique, la question importante de la femme et le cinéma bien entendu, Nasr Abu Zayd et sa « critique du discours religieux »[5] , Abu Zayd qu’elle évoque comme un élément en filigrane du décor du roman ; et enfin notre attachement commun et infaillible à la culture française et à Paris, lieu d’ouverture majeur, venant tous les deux d’horizons différents.
Cette première œuvre remarquable et remarquée de May Telmissany est le récit romancé d’une souffrance qui appartient exclusivement au monde féminin, une souffrance du cœur en même temps que du corps : la perte prématurée d’un premier enfant, qui devient déjà absent sans avoir eu le temps d’être présent[6]. May Telmissany exprime dans ce texte un cri, une douleur et un deuil progressivement salvateur, qui lui sont personnels et dont elle ne s’est jamais cachée, en égyptienne profonde, imprégnée des codes de son pays natal et ayant dans le même temps les clés de ceux de ce que l’on appelle communément « l’Occident » où elle vivait déjà et de la littérature duquel elle s’est largement imprégnée[7].
Tout ceci est fait sans détours et sans complexes comme une façon de rendre la parole à la femme à travers la littérature, dans un contexte où elle ne l’avait pas ou elle l’avait de moins en moins.
Son éditeur égyptien de l’époque eut alors ces mots exceptionnels de sens et de concision que l’on peut lire sur la quatrième de couverture de l’édition française du roman: « Doniazade meurt sans avoir pu quitter la matrice du récit. L’écriture rejoint ainsi l’une de ses fonctions premières : donner vie à l’ombre des choses perdues. »
Lavée entièrement et blanchie notamment par le journal Al Ahram de son aveu même, après des premières réactions négatives, May Telmissany l’avant-gardiste, s’est révélée comme une romancière novatrice et reconnue[8], qui se moque des usages et des frontières dressées par les préjugés, pour s’atteler entièrement à une œuvre intimiste, jusqu’auboutiste dans l’expression d’une féminité forte et sincère qui vient d’Egypte et qui restera dans l’histoire comme fragment de cette « littérature-monde » chère à Michel Le Bris.
Aujourd’hui « La Doctora » May Telmissany, fait autorité dans son pays, reconnue et respectée pour son engagement malgré toutes les difficultés qu’une femme résolument tournée vers le monde extérieur en même temps que vers sa terre natale, à l’image de sa littérature, peut rencontrer dans le pays qui enfanta notamment le mouvement des « frères musulmans » au vingtième siècle.
Paradoxalement, les égyptiens tirent une fierté (malgré donc une forme de méfiance voire d’hostilité chez certains) de la notoriété de May et se souviennent très bien de sa famille, basée dans le quartier d’ « Héliopolis » conçu par le baron Empain, l’industriel belge.
Un quartier immortalisé dans le second roman de May traduit en France[9].
Les el-Telmissany (dont la racine serait el-telemssany, an arabe « le tlémecénien ») sont originaires de Tlemcen en Algérie, signe d’une autre ouverture d’esprit, qui fait dire entre autres, à notre romancière, qu’elle comprend la revendication culturelle berbère en Algérie et au Maroc notamment grâce à des échanges avec ses étudiants berbères au Canada.
Le père de May Telmissany, Abdelkader el-Telmissany, décédé en 2003, est un pionnier du cinéma documentaire égyptien qui avait fait ses études de cinéma à Paris. Ses deux oncles, Kamel et Tarek sont également dans le cinéma, respectivement pionnier du réalisme dans le cinéma égyptien et un autre pionnier du cinéma documentaire. Son cousin Tarek el- Telmissany est un célèbre directeur de la photographie.
Ce second roman est également une autofiction, l’histoire de Micky, « jeune et capricieuse narratrice », située entre sa cinquième et sa quinzième année, dans cet univers cairote déjà perdu ou « effondré » comme dans le célèbre roman du nigérian Chinua Achebe. Une histoire qui dialogue avec (en même temps qu’elle s’imbrique dans) celle de quatre autres femmes, qui ne sont autres que sa mère, sa grand-mère et ses deux tantes. Un texte traversé par des accents sartriens dans les « mots » : « le sentiment de Micky d’être une marionnette n’est ni fortuit ni subsidiaire » et de Pérec dans « les choses », ces « objets » intimes et banalement quotidiens (ou quotidiennement banals) de ces quatre femmes mis explicitement en évidence comme des repères dans ce texte très féminin lui aussi, et ancré comme le premier dans cet univers telmyssénien qui prend forme aux yeux du lecteur au fur et à mesure des romans.
Seconde rencontre à Paris en avril 2014 dans le huitième arrondissement cette fois-ci, dans le bureau de l’expert-comptable/commissaire aux comptes, Mohamed Saadi, Directeur de la Berbère Télévision, qui lui apprend que le groupe audiovisuel est en train de « s’installer » au Canada, et un entretien d’une heure trente minutes où nous évoquons son troisième roman dans un bonheur inhérent à l’émulation intellectuelle qu’elle suscite et à cette humanité qu’elle dégage et qui vous fait penser que vous la connaissez depuis toujours.
Feuilletoniste moderne comme naguère Balzac, Dumas ou Charles Dickens, May Telmissany a entrepris la rédaction d’un roman feuilleton dans un journal du Caire. Cette histoire qu’elle a racontée en tenant en haleine les lecteurs pendant des semaines est devenue un roman au thème plutôt osé, publié en 2012 (et en arabe) au Caire et en 2014 aux éditions Actes Sud en France.
A capella est le roman d’un aboutissement, celui d’une écrivaine qui impose désormais son rythme et son style, qui nous mène cette fois-ci le long de chemins glissants et terriblement anticonformistes. Elle inscrit son texte dans une forme d’universalité qu’elle choisit sans doute pour bousculer davantage les usages. Mais si l’histoire n’est pas située dans le temps et dans l’espace, quelques signes sont là pour rappeler probablement la ville du Caire dans une Egypte moderne (le fleuve, les usages sociaux, les prénoms karim, Mahi, Adel, Houssam…). D’autres indices semblent délibérément semés ça et là pour faire « diversion » comme, à titre d’exemple, les prénoms de Aïda qui est la plaque tournante du roman, et d’un des personnages masculins, Léo, qui est un de ses deux ex-maris. En dehors de cela, point, dans le décor quotidien, d’évocation de la lutte d’un peuple pour son émancipation et sa survie, ni de la menace lancinante sur ce même peuple et sur les femmes en particulier, notamment lorsqu’elles sont terriblement libres comme Aïda, par une idéologie archaïque et dangereuse d’un côté et par un pouvoir aux mains des militaires de l’autre.
L’autre forme de diversion pratiquée par May Telmissany est la question qui traverse tout le roman pour le lecteur sur le caractère autobiographique ou non d’un écrit qui va plus loin que d’habitude dans la transgression des tabous liés à la femme.
Mahi (le double de May que l’on retrouve sous le surnom de Micky dans « Héliopolis ») est une femme rangée, amoureuse, fidèle et fortunée, avec une famille « comme il faut », un enfant, un mari sincèrement aimé mais totalement absent, physicien englué dans une science dénuée de sensibilité aux choses du monde et surtout aux tourments féminins, pensant avoir une explication rationnelle et scientifique à toutes sortes de questionnements ; une belle-mère issue d’une bourgeoisie aisée, suffisamment marquée par les lourdeurs de la tradition pour devenir un réel obstacle à l’expression d’une individualité pourtant indispensable à l’épanouissement personnel que Mahi appelle de ses vœux. Un monde si proche et si lointain de la sensibilité (qui s’affirme progressivement) de Mahi, femme conventionnelle qui n’a pas d’autre univers a priori que cette réalité dorée, enviable selon le positionnement que l’on a, mais immobile et ennuyeuse même si l’amour est là, stable et réel et ce n’est pas le moindre des paradoxes.
La vie de Mahi est, si l’on veut faire une interprétation hâtive, socialement, et du point de vue de ce que nous pourrions trivialement nommer la « vitrine », exceptionnellement réussie mais intérieurement, elle tend inexorablement vers une sorte de mouroir de première classe. Les choses ne se révèlent à ses yeux sous cette forme quasi-monstrueuse, qu’après une amitié avec la sulfureuse et sans doute l’associable Aïda, au tempérament diamétralement opposé.
Le roman se présente comme une graduelle réflexion de Mahi sur elle-même et sur le monde suite à la fréquentation puis au décès d’Aïda et enfin à la découverte de son journal intime. Son existence qui va en être bouleversée et un besoin impérieux de comprendre et aussi d’écrire ce texte quasi à deux voix.
Aida ( On pense à Verdi, mais aussi « celle qui revient » en arabe ) est comme une saltimbanque délurée et instable, cleptomane, malheureuse en amour, collectionneuse d’hommes, comptant à son actif deux mariages et des avortements que Mahi ne peut compter, car la vie Aïda est jonchée de mensonges et de tromperies, dépensant sans compter l’argent des autres si nécessaire et appréciant peu la compagnie des femmes.
Elle est issue d’une famille pauvre et telle « Gatsby le Magnifique » de Fitzgerald, doit souffrir intérieurement de cette condition ancienne qu’elle aspire maladroitement à oublier et dépasser.
Alors que Mahi en fait une proche amie, visiblement la seule en dehors de sa propre famille, Aïda semble se méfier de son côté de Mahi et ne pas la considérer comme une amie intime, ce que découvrira Mahi dans le fameux journal.
Aïda a par ailleurs des qualités artistiques et littéraires. Peintre et poète à ses heures, elle n’a néanmoins aucune autre activité régulière ou rémunérée tout en paraissant toujours débordée. L’instinct maternel, qui pourrait aussi être vu comme un moyen d’asservissement de la femme, semble étranger à son univers. Elle est entourée de quatre hommes qu’elle voudrait manipuler à sa guise comme des marionnettes et qui ne sont délibérément qu’un décor dans cette histoire terriblement féminine, comme quatre prétextes pour exprimer deux féminités différentes qui vont se rapprocher après l’électrochoc que Aîda va créer, vraisemblablement malgré elle, en Mahi.
Aïda est une femme libre jusqu’à la transgression des règles les plus élémentaires de la société dans laquelle elle vit. Elle exprime une vengeance sur une souffrance originelle, celle d’un univers qui culpabilise la féminité et la femme, et qui a notamment la phobie du désir et de la liberté de la femme de disposer de son corps.
Mahi ne juge pas Aïda. Son comportement la questionne sur elle-même et va même l’inspirer. Elle est donc au contraire ébranlée dans ses certitudes en tentant de pénétrer ou de « photographier » rigoureusement le cerveau d’Aïda.
A capella est un très beau texte sur le questionnement sincère sur soi, de soi, sur le poids de l’empathie et sur la construction de la littérature à travers la capacité à en avoir pour les autres.
Les égarements justement d’Aïda et sa supercherie deviennent enviables car ils convoquent le désir d’autre chose chez Mahi. Aïda paie le prix de son comportement par une vie somme toute malheureuse et instable jusqu’à la mort, même si elle est souvent pleine de surprises et d’allant.
La littérature comme instrument de réflexion sur les autres et donc sur nous-mêmes : chanter sa vie à capella n’est probablement pas suffisant même si l’on possède une très belle voix.
May Telmissany vous quitte en vous confiant son désir de se consacrer totalement à la littérature car elle en est habitée, et à propos d’un nouvel hebdomadaire que je lui montre et qui pose la question de la capacité encore de la France à faire rêver, elle répond « oui » sans hésitation.
Hafid ADNANI
Paris le 21 avril 2014
[1] Editions Actes Sud- 2014
[2] Tout comme le talentueux Alaa Al Aswany, qui nous offre lui à lire une peinture d’une Egypte à la fois merveilleuse et menacée par la décadence et l’obscurantisme
[3] Sculptures répétitives – Dar Sharquiat – le Caire - 1995
[4] Doniazade - Dar Sharquiat_ Le Caire- 1999
[5] Trqduit en 1999 aux éditions Actes Sud. Nasr Abu Zeid s’est exilé aux Pays-Bas jusqu’à son décès en 2010, après avoir été poursuivi par les islamistes pour ses opinions sur le Coran.
[6] Cette absence est ramenée à celle de la sœur de Shéhérazade dans Les Mille et une nuits, Doniazade, qui est sous le lit conjugal et qui traverse le récit tout en étant absente
[7] May Telmissany a travaillé, à titre d’exemple, pour son projet de maitrise, sur Marcel Proust.
[8] Notamment par le prix de l’encouragement de l’Etat (Caire) pour le meilleur roman autobiographique.
[9] Heliopolis- Actes Sud – 2003. Paur en 2000 et en arabe au Caire – Ed Sharqiyät.